Pour faire suite à deux de mes billets sur les débats entourant Rio+20, le dernier qui traitait de la main mise supposée du capitalisme sur l’économie verte et le second qui abordait la question de savoir s’il nous fallait faire nos adieux à la croissance, je poursuis ici la réflexion sur l’état des lieux de la question écologique au sein des mouvements sociaux et dans le développement des communautés en me faisant l’avocat du diable sur quelques idées reçues concernant la décroissance, les indignés et le développement des communautés à la base. Âmes sensibles s’abstenir !
Trois mythes me semblent persister au sein d’organisations pour lesquelles les indignés et la décroissance sont devenus la clé susceptible de favoriser de grands changements :
- Le premier a trait à la décroissance présentée sur le terrain de l’écologie comme la solution passe-partout. Or ce courant de pensée ignore ou fait fi généralement de la montée du développement durable depuis 20 ans tant dans les institutions internationales que dans les mouvements sociaux. Faut-il dès lors se donner la peine de s’attarder à la notion d’économie verte nous disent-ils ?
- Le second concerne les indignés. Ils représentent l’avenir. Rien n’est moins sûr que cette proposition. D’abord cela dépend du pays où ils ont émergé. En Espagne c’est fort possible. En France, c’est beaucoup moins évident et au Québec, le mouvement étudiant a été nettement plus influent jusqu’ici pour la suite des choses. Derniers venus dans l’univers de la mobilisation sociale de toute nature, la survalorisation des indignés a tendance à faire oublier d’autres mouvements comme les syndicats, le mouvement des femmes, le mouvement communautaire, les organisations paysannes et de producteurs agricoles…Ces différents mouvements se seraient-ils assagis et adaptés à ce point au capitalisme ?
- Le troisième est lié aux vertus quasi-exclusives du travail à la « base » : tout se passe et va se passer dans les communautés locales, tout passe par les initiatives d’une économie de proximité dans ces communautés. Mais qu’en est-il le rôle des États et du rôle de l’action politique (celle des partis progressistes comme celle des mouvements sociaux) ? Et qu’en est-il de la recherche d’une alternative globale car les alternatives locales auront beau se multiplier par dizaines de milliers, on se doute bien que cela ne sera pas suffisant à changer le monde ?
1. Sur le premier point qu’est la décroissance
La place faite à la décroissance dans certaines organisations peut faire oublier la contribution des mouvements en commençant par le mouvement écologique lui-même (toutes familles confondues) et le rôle des ONG en environnement depuis Rio 1992 jusqu’à Rio+20 autour de la notion de développement durable et l’itinéraire de cette notion depuis 40 ans (20 ans comme notion forte dans l’espace public) dans les mouvements sociaux, les ONG et les institutions internationales.
L’absurde croissance est à la porte si on parle de croissance dans le sens où l’économie mondiale, par ses multinationales de pointe, viserait à ce que toutes les populations de la terre atteignent le même niveau de vie que les Américains laissant croire par là que la planète pourrait s’en tirer sans trop de mal. Parler de cette absurdité en termes généraux et normatifs et de la croissance comme si c’était un bloc monolithique ne suffit pas à nous convaincre. Parce que l’action collective n’est pas que l’expression de valeurs ou de convictions. Il faut penser stratégie et donc concevoir mobiliser sur des objectifs précis et réalisables en prenant en compte la durée, les forces réellement existantes et la conjoncture telle qu’elle se présente aujourd’hui.
Il faut considérer que le mouvement écologique (toutes familles confondues) a beaucoup fait à partir de la notion de «développement durable» pour que progresse une conception autre de l’économie et de la société. Cette notion, qui avait été précédé par celle d’«écodéveloppement», a en effet effectué une percée majeure depuis 20 ans, tant au plan sociopolitique (par certaines politiques publiques, par certaines initiatives fortes des coopératives et de l’économie solidaire, par des conversions industrielles vers la production d’énergies renouvelables soutenue sinon initiée par des syndicats, etc.) qu’au plan conceptuel (sa pénétration dans plusieurs grandes institutions internationales). Or où en sont rendues aujourd’hui les organisations de ce mouvement ? Elles posent la question de façon pratique et politique une fois enregistré le fait qu’il y a urgence écologique : Qu’allons-nous faire croître ? Qu’allons-nous faire décroître ? Cela conduit à la construction d’un rapport de forces et d’une mobilisation autour de deux pôles :
a) S’assurer de développer massivement des filières durables comme celle des énergies renouvelables (éolien, solaire, géothermique) ; comme celle de l’agriculture écologiquement intensive à grande échelle (pas seulement au niveau micro) ; comme celle de la biomasse de 2e génération ; comme celle de la biométhanisation (biogaz à partir de nos déchets domestiques pour remplacer le pétrole des véhicules mobilisés par le service public) ; comme celui l’aménagement durable des forêts sous gestion de coopératives ; comme celui du transport collectif par monorail électrique reliant Montréal, Québec et les principales villes régionales (Trois-Rivières, Saguenay, Sherbrooke…) tel que l’avance une étude de faisabilité de l’Institut de recherche économique contemporaine (IREC).
b) S’assurer d’inciter, voire de forcer la décroissance dans d’autres filières comme la conversion de raffineries de pétrole, le moratoire sur le gaz et le pétrole de schiste, le refus de voir des minières s’alimenter au diesel plutôt qu’à l’électricité dans le développement du plan Nord, etc.
Dans cette perspective, je ne peux passer sous silence la plateforme commune produite récemment par huit grandes organisations écologistes à la faveur des élections québécoises du 4 septembre et rendue publique le 14 août. Elle fait preuve d’une grande maturité politique (par leur intervention en coalition, par la clarté de leurs propos, par la faisabilité des demandes exprimées, par leur capacité de démonstration). Et elle exprime bien ces deux pôles d’une action concertée travaillant sur la conjoncture actuelle. Leur positionnement sur la forêt, les mines, le pétrole et le gaz de schiste, les transports et l’économie verte déplie une série de propositions à mettre en place dans les prochaines années au Québec avec l’horizon de l’indépendance énergétique du Québec. Une inspiration qu’on souhaiterait se répercuter et être reprise par d’autres mouvements [1] .
En fait, un peu comme l’avance l’économiste Alain Lipietz du Parti Vert français dans son dernier billet de blogue : La transition énergétique exige en gros : un tiers de « sobriété volontaire » chère au « décroissants » (mettre un pull-over plutôt que pousser le chauffage, pratiquer le vélo et le covoiturage…), un tiers d’investissements dans l’efficacité énergétique (réseaux de transports en commun, isolation thermique des bâtiments), et un tiers d’investissement dans les énergies renouvelables (de la méthanisation aux capteurs solaires en passant par l’éolien et l’hydraulique). Ces deux derniers tiers sont le lieu d’une massive création d’emplois directs. Évidemment, cette croissance de l’activité se traduira de façon comptable par une croissance du PIB. Eh oui ! La décroissance de l’empreinte écologique implique une croissance économique …ajoute-t-il.
L’économiste Gadrey dans un texte déjà paru sur Oikos à propos de l’économie verte dit des choses qui vont dans la même direction: L’économie verte peut être la meilleure ou la pire des choses du point de vue des perspectives du « bien vivre dans un monde soutenable ». On est du côté du meilleur dans certains programmes cherchant à mettre l’économie au service de la transition écologique et sociale, sur un mode démocratique. On est du côté du pire avec le lobbying non dénué de succès des multinationales et de la finance auprès des États et des Nations Unies dans le cadre de la préparation du sommet de Rio + 20.
 On pourrait même aller jusqu’à dire que la transition écologique de l’économie peut négocier des arrangements avec des entreprises du «capitalisme vert». La réponse d’un certain nombre d’organisations évoluant dans la mouvance de l’altermondialisme à ce propos est une réponse négative parce que le capitalisme, par définition, serait incompatible avec la recherche d’une économie durable. Réponse un peu courte ! Pourquoi ? Parce que, d’une part, ce capitalisme vert (à ne pas confondre avec le {green washing} des multinationales) est extrêmement minoritaire comparativement au camp adverse composé de puissantes multinationales dans les secteurs de l’agroalimentaire, du nucléaire, du pétrole, de l’automobile lesquelles se sont dotées de lobbies de plus en plus en plus influents. D’autre part parce que ce capitalisme vert est sous haute surveillance des mouvements, des municipalités et même d’États qui refusent de se faire inféoder. Ce à quoi on peut ajouter qu’avec toutes les économies alternatives (communautaire, sociale, coopérative, etc.), on n’y arrivera pas. Car ici, c’est la question de la transition qui est posée. Pour en savoir plus à ce propos, mon dernier livre (co-signé avec l’économiste de Fondaction, Mario Hébert) développe précisément cette question de la transition écologique de l’économie laquelle est un processus dans la durée s’inscrivant dans un rapport de forces tout à la fois local, national et mondial (Favreau et Hébert, 2012).
On pourrait même aller jusqu’à dire que la transition écologique de l’économie peut négocier des arrangements avec des entreprises du «capitalisme vert». La réponse d’un certain nombre d’organisations évoluant dans la mouvance de l’altermondialisme à ce propos est une réponse négative parce que le capitalisme, par définition, serait incompatible avec la recherche d’une économie durable. Réponse un peu courte ! Pourquoi ? Parce que, d’une part, ce capitalisme vert (à ne pas confondre avec le {green washing} des multinationales) est extrêmement minoritaire comparativement au camp adverse composé de puissantes multinationales dans les secteurs de l’agroalimentaire, du nucléaire, du pétrole, de l’automobile lesquelles se sont dotées de lobbies de plus en plus en plus influents. D’autre part parce que ce capitalisme vert est sous haute surveillance des mouvements, des municipalités et même d’États qui refusent de se faire inféoder. Ce à quoi on peut ajouter qu’avec toutes les économies alternatives (communautaire, sociale, coopérative, etc.), on n’y arrivera pas. Car ici, c’est la question de la transition qui est posée. Pour en savoir plus à ce propos, mon dernier livre (co-signé avec l’économiste de Fondaction, Mario Hébert) développe précisément cette question de la transition écologique de l’économie laquelle est un processus dans la durée s’inscrivant dans un rapport de forces tout à la fois local, national et mondial (Favreau et Hébert, 2012).
2. Sur le second qui est celui de la contribution des indignés
 La démocratie est faite de mouvements (les organisations dites de la société civile) et d’institutions c’est-à-dire les différentes composantes d’un État démocratique et social soit des écoles, des hôpitaux, des élections et donc des partis politiques, une assemblée nationale, des médias, des conseils régionaux de développement…. toutes ayant des comptes à rendre à la population de diverses façons. Une société sans institutions démocratiques ne produit rien de durable. Une société sans mouvements est soumise à la tentation autoritaire, ce qui est le lot de très nombreux pays sur la planète (40% des pays dans le monde sont partiellement libres et un autre 40% des pays est composé de régimes autoritaires de dire le sociologue Guy Rocher (Rocher, 2001).
La démocratie est faite de mouvements (les organisations dites de la société civile) et d’institutions c’est-à-dire les différentes composantes d’un État démocratique et social soit des écoles, des hôpitaux, des élections et donc des partis politiques, une assemblée nationale, des médias, des conseils régionaux de développement…. toutes ayant des comptes à rendre à la population de diverses façons. Une société sans institutions démocratiques ne produit rien de durable. Une société sans mouvements est soumise à la tentation autoritaire, ce qui est le lot de très nombreux pays sur la planète (40% des pays dans le monde sont partiellement libres et un autre 40% des pays est composé de régimes autoritaires de dire le sociologue Guy Rocher (Rocher, 2001).
La place faite aux indignés dans certaines analyses se fait en négligeant les mouvements sociaux qui les ont précédé et qui assurent les assises d’une démocratie sans cesse renouvelée. Je pense en particulier au mouvement paysan, au mouvement des travailleurs, au mouvement des femmes et au mouvement coopératif. Or, pour les avoir étudié de plus près, ils sont en plein renouvellement depuis une décennie (Favreau, Fréchette et Lachapelle, 2010), justement à cause de la crise.

Invité par l’AQOCI, C.Whitaker sera parmi nous en novembre http://www.jqsi.qc.ca
Précisons ici que le concept de mouvement social a généralement deux sens (Whitaker, 2003 : 39-42) : d’abord celui d’une action collective entreprise par des militants qui ont une cause spécifique à défendre et des objectifs concrets, limités dans le temps et l’espace, avec des stratégies, des règles de fonctionnement, des plans d’action et des structures appropriées. On parle alors de « mouvements » qui sont pluriels dans leur composition sociale, leurs orientations, leurs règles, leurs manières de faire. Il suffit de penser au mouvement syndical, au mouvement des femmes, aux organisations paysannes et au mouvement écologique pour voir se dessiner les contributions particulières des uns et des autres.
Ensuite, il y a, plus rarement, cette action collective fédérative de plusieurs types d’organisation et de causes spécifiques où se dessinent peu à peu des convergences. Il s’agit alors d’un processus de longue durée qui peut grandir au fil des ans. On parle alors du «mouvement» parce qu’il y a différentes causes et courants en interaction dans la durée. C’est de cela qu’il s’agit lorsqu’on utilise la notion de mouvement « altermondialiste ». Or l’inédit des années 2000, c’est que bon nombre de mouvements, de caractère et de portée surtout national et spécifique, ont commencé à investir l’espace international en participant à l’émergence de ce mouvement citoyen international de type nouveau dont nous avons déjà traité sur ce blogue. Dans les deux registres, celui des « mouvements » et celui du « mouvement », comparativement aux années 1980-1990, le progrès est plus que sensible.
C’est le cas du mouvement international des travailleurs. Au delà des affiliations syndicales traditionnelles, dans le Nord comme dans le Sud, affiliations qui le divisait fortement en trois familles (la chrétienne, la social-démocrate et la communiste), il s’est formé, à Vienne en 2006, une seule et grande centrale syndicale internationale, la Confédération syndicale internationale (CSI). Suite à ce congrès fondateur, le mouvement d’unification dans plusieurs pays du Sud de même que sa structuration continentale unique en Afrique comme en Amérique latine a progressé substantiellement. La CSN, la FTQ et le CTC ont d’ailleurs participé, à des degrés divers, à la constitution de son organisation sur le continent, la Confédération syndicale des Amériques (CSA), laquelle a même organisé début 2009 -c’était une première- un Forum syndical mondial dans le cadre du Forum social mondial (FSM) qui se tenait à Belem au Brésil.
C’est également le cas du mouvement international des agriculteurs et des paysans. La Fédération internationale des producteurs (la FIPA dont l’UPA est membre) s’est aussi beaucoup transformé dans les 20 dernières années : modification des structures pour favoriser la présence des organisations paysannes du Sud, Comité de développement pour le soutien aux organisations du Sud… La FIPA a été dissoute en 2010 et une autre organisation est en voie de formation depuis. De plus il faut compter qu’une autre organisation internationale a émergé au cours de la dernière décennie, {Via Campesina}, dans la foulée même du Forum social mondial (FSM).
 Cela est également perceptible dans le mouvement international des coopératives. L’Alliance coopérative internationale (ACI) a amorcé des changements majeurs depuis une quinzaine d’années : débat majeur autour du renouvellement de sa déclaration de principes et restructuration de tout le mouvement en fonction des différents continents (l’ACI était auparavant dirigée depuis l’Europe), favorisant du coup l’entrée de ressources humaines et financières dans les pays du Sud pour soutenir leur développement coopératif.
Cela est également perceptible dans le mouvement international des coopératives. L’Alliance coopérative internationale (ACI) a amorcé des changements majeurs depuis une quinzaine d’années : débat majeur autour du renouvellement de sa déclaration de principes et restructuration de tout le mouvement en fonction des différents continents (l’ACI était auparavant dirigée depuis l’Europe), favorisant du coup l’entrée de ressources humaines et financières dans les pays du Sud pour soutenir leur développement coopératif.
Finalement, depuis 2001, le coup d’envoi du Forum social mondial est venu introduire une coordonnée de plus à cette dynamique car toutes ses organisations sont désormais invitées à s’inscrire dans un mouvement citoyen international naissant à côté des nouveaux réseaux de groupes de femmes, de commerce équitable, de protection de l’environnement, d’économie solidaire, etc. (Favreau, Fréchette et Lachapelle, 2010).
3. Sur le troisième point : le travail à la base dans les communautés
C’est un vieux problème du développement communautaire : face aux politiques « top down » des États jugées inefficaces, voire inappropriées, la tentation est grande d’adopter une position ou/et une conviction que le changement social ne se fera que par le « bottom up », c’est-à-dire dans le « développement par le bas » (Sanyal, 1999). Les projets « bottom up » sont très souvent anti-étatistes, branchés sur une intervention à petite échelle, dans des contextes où les canaux institutionnels permettant aux populations et à leurs organisations de se faire entendre sont faibles ou inexistants. La proximité des populations, la plus grande agilité présumée de ce type d’intervention (dépourvue de bureaucratie), l’autonomie à l’égard de toute institution…sont les caractéristiques le plus souvent mises en valeur dans ce travail de mobilisation locale. Peut-être un peu trop !
 Car cette stratégie a aussi ces limites : l’efficacité structurante de ces projets est pour la plupart du temps assez faible au plan économique. Par exemple le marché pour les produits de cette économie très locale est relativement réduit. Et l’influence qu’ils ont sur les institutions (les partis politiques et les élus notamment) est souvent nulle. Sans compter la rivalité entre ONG toutes en quête de financement public international s’alimentant plus souvent qu’autrement aux mêmes sources.
Car cette stratégie a aussi ces limites : l’efficacité structurante de ces projets est pour la plupart du temps assez faible au plan économique. Par exemple le marché pour les produits de cette économie très locale est relativement réduit. Et l’influence qu’ils ont sur les institutions (les partis politiques et les élus notamment) est souvent nulle. Sans compter la rivalité entre ONG toutes en quête de financement public international s’alimentant plus souvent qu’autrement aux mêmes sources.
Le « basisme » fait peu de cas des conditions réelles de réussite observées dans de nombreuses recherches au Québec (Bourque et alii 2007 ; Bourque, 2008 ; Bourque et Lachapelle 2010) et au Sud (Ndiaye, 2005 ; Sanyal, 1999 ; Fonteneau, Nyssens et Fall, 1999). Quelles sont ces conditions ? Globalement trois acteurs qui convergent et favorisent la rencontre d’un mouvement ascendant (« bottom up ») et d’un mouvement descendant (le « top down ») :- La capacité d’ONG à mobiliser les leaders de communautés locales et à créer des passerelles avec les institutions locales ;
– L’appui actif d’institutions locales (le centre communautaire, le dispositif local de microfinance, les églises locales, la commune ou la municipalité…) ;
– L’ouverture des pouvoirs publics aux demandes des communautés ou, à tout le moins, pour les forces vives de ces communautés, un lien fort avec des organisations coopératives, syndicales ou paysannes nationales disposant de filières d’entrée au sein de l’État.
Car l’objectif à terme est non seulement de créer des communautés fortes mais de construire ou de reconstruire un État social. Or trois volets sont constitutifs de cette construction d’un État social:
– La transformation des rapports de travail : faire exister un droit du travail, reconnaître le syndicalisme dans les principaux secteurs de l’économie, développer une politique de l’emploi, développer une politique de soutien à l’économie populaire. Cela est très peu pris en compte dans le «travail à la base» des ONG ;
– En arriver à produire des services collectifs de base de caractère public en matière de santé, de services sociaux, d’éducation… et donc un minimum de politiques sociales. La tentation est grande de s’en tenir à des services communautaires sans lien avec l’impératif de développement d’un service public ;
– Des politiques économiques axées sur le renforcement des territoires en matière d’emploi, de développement régional, de formation de la main d’oeuvre… Ce type de développement est souvent oublié ou négligé.
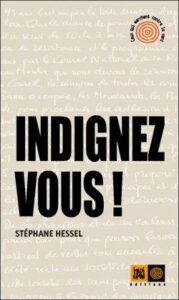 La conception d’un État social digne de ce nom a pu se développer dans les sociétés du Nord à la faveur de luttes sociales, notamment grâce aux mobilisations du mouvement ouvrier (syndicats, coopératives et partis politiques de gauche) et du mouvement des femmes, luttes qui ont donné le maximum de leur efficacité en étant coordonnées, convergentes, portées par des organisations capables de multiplier les échelles d’intervention. Le plus bel exemple est celui du programme du Conseil national de la Résistance (CNR) en France et son expérience d’unité au lendemain de la 2e guerre mondiale tel que relaté par Stéphane Hessel dans son essai publié en 2010 Indignez-vous !
La conception d’un État social digne de ce nom a pu se développer dans les sociétés du Nord à la faveur de luttes sociales, notamment grâce aux mobilisations du mouvement ouvrier (syndicats, coopératives et partis politiques de gauche) et du mouvement des femmes, luttes qui ont donné le maximum de leur efficacité en étant coordonnées, convergentes, portées par des organisations capables de multiplier les échelles d’intervention. Le plus bel exemple est celui du programme du Conseil national de la Résistance (CNR) en France et son expérience d’unité au lendemain de la 2e guerre mondiale tel que relaté par Stéphane Hessel dans son essai publié en 2010 Indignez-vous !
Cet État social est, bien sûr, à renouveler au Nord car il a en partie reporté en sous-traitance bon nombre de services collectifs (services refilés au secteur privé ou au secteur associatif). Et les gouvernements successifs, surtout avec la crise que traverse la planète depuis cinq ans, restent souvent coincés sur la seule dynamique de la démocratie représentative alors que la démocratie oeuvre aussi dans le registre délibératif (consultation des forces sociales et dialogue social entre partenaires…) et dans le registre associatif (reconnaissance de la société civile, de son autonomie et de sa légitimité [2]).
Au Sud, il est à reconstruire parce les programmes d’ajustement structurel (PAS) ont littéralement démantelé ce qui avait commencé à émerger dans les années 1960 et 1970. C’est que le rapport impôts/citoyenneté bâti sur plusieurs décennies dans les pays du Nord n’a pas eu lieu encore dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.
Cela surprendra sans doute mais, historiquement, la démocratie a reposé sur une philosophie politique qui donnait à l’impôt le fondement premier de la citoyenneté. En d’autres termes, une fiscalité obtenue sur un financement librement consenti des citoyens d’un même pays. Et cet impôt est le prix que nous payons pour avoir collectivement des services publics : des enseignants, des infirmières, des travailleurs sociaux, des routes, de l’électricité à moindre coût, une collecte sélective des déchets, des espaces aménagés pour les loisirs, des mesures en faveur de l’emploi des jeunes, en faveur de l’habitat coopératif et communautaire…Réalité souvent oubliée ou perdue de vue notamment par les générations qui n’ont pas eu à lutter pour que le Québec en arrive là et qui se disent trop taxées.
L’impôt étant le prix que l’on paie comme citoyens pour avoir des services collectifs, cet impôt doit être considéré comme la première expression de la citoyenneté et de la démocratie. Pourquoi ? Parce que l’argent des impôts sert à financer des services publics accessibles à tous, qu’il favorise une certaine redistribution de la richesse et agit sur l’économie et l’emploi, le développement de nos communautés…. En d’autres termes, la force de ce lien entre citoyenneté et impôt est le point de jonction de la redistribution de la richesse et de la démocratie.
C’est là toute la base des relations entre l’économie et nos institutions démocratiques. Sans institutions et mouvements démocratiques, l’économie est laissée à elle-même et la croissance considérée comme source automatique de progrès social et culturel (pensée néolibérale). La démocratie fonctionne autrement : elle s’appuie en premier lieu sur les élus qui nous représentent, les débats à l’Assemblée nationale, les Commissions sur plein de dossiers chauds. Puis il y a les gouvernements locaux qui cherchent à se tailler une place par rapport aux gouvernements centraux. Mais la démocratie n’est pas que représentative. Elle est aussi faite de milliers d’associations de toutes sortes : des centres communautaires de quartier, des coopératives, des syndicats de travailleurs, des organisations qui soutiennent le développement socioéconomique de leur communauté, des organisations de coopération internationale, des groupes de femmes, des réseaux de jeunes, des organisations d’agriculteurs, des groupes de femmes, des associations de retraités…

C’est dans cette perspective que le développement local doit penser son intervention s’il veut devenir durable et solidaire. Les comités de citoyens mobilisés pour un moratoire sur le gaz de schiste dans la Vallée du Richelieu l’ont très bien compris : a) ils se sont d’abord regroupés sur une base interrégionale ; b) ils ont aussi commencé à réfléchir sur les alternatives au gaz de schiste et plus largement à la question de l’indépendance énergétique du Québec à l’égard des énergies fossiles ; c) ils s’internationalisent en développant des passerelles avec leur alter ego en Europe (en France et en Pologne) et dans le nord-est américain.
Pour en savoir plus
Bourque, D. (2008), Concertation et partenariat. Entre levier et piège du développement des communautés, PUQ, Ste-Foy.
Bourque, D. et R. Lachapelle (2010), L’organisation communautaire en CSSS, PUQ, Québec.
Bourque, D., Y., Comeau, L. Favreau, et L. Fréchette (2007). L’organisation communautaire. Fondements, approches et champs de pratique. PUQ, Sainte-Foy.
Favreau, L. et M. Hébert (2012), La transition écologique de l’économie. Contribution des coopératives et de l’économie solidaire. PUQ, Québec. Sous presse, parution à la mi-septembre.
Favreau, L., L. Fréchette et R. Lachapelle (2010), Mouvements sociaux, démocratie et développement. Les défis d’une mondialisation solidaire. PUQ, Québec.
Fonteneau, B., M. Nyssens et A.S. Fall (1999) « Le secteur informel : creuset de pratiques d’économie solidaire ? » dans Defourny, J., Develtere,
P. et B. Fonteneau (1999), L’économie sociale au Nord et au Sud, Éd. De Boeck Université, Collection Ouvertures économiques, Paris/Bruxelles, pp. 159-178.
Ndiaye, S. (2005). Économie populaire et développement local en contexte de précarité : l’entrepreneuriat communautaire au Sénégal. Thèse de doctorat en sociologie, UQAM, Montréal. Disponible à la bibliothèque de l’UQAM.
Rocher, G. (2001), L’idée du siècle, la liberté du citoyen. Entretien avec G.Rocher par M.Lacombe, Radio-Canada et Fides, Montréal, p.67 à 80.
Sanyal, B. (1999). « Potentiel et limites du développement par le bas », dans J. Defourny, P. Develtere et B. Fonteneau, L’économie sociale au Nord et au Sud, Paris / Bruxelles, DeBoeck, p. 179-194.
Whitaker, C. (2003), Propos tenus dans le livre collectif Où va le mouvement altermondialisation ? Paris, La Découverte.
[1] Bien résumée dans le journal La Presse du 14 août. Document complet d’une douzaine de pages sur le site des différents groupes dont celui de l’AQLPA
[2] Au Québec, le comportement du gouvernement libéral à l’égard du mouvement étudiant pendant la crise de ce printemps-été 2012 a été particulièrement révélateur à cet égard. Ce gouvernement a pratiqué le déni complet d’une démocratie autre que représentative.
Louis Favreau
Articles de cet auteur
- Solidarité internationale en temps de pandémie : pompiers de service ou architectes du développement ?
- Développement économique local dans les pays du Sud : l’avenir des services énergétiques
- Solidarité internationale et développement des communautés à l’heure de l’urgence climatique
- Agriculture au Québec et dans le monde : la transition sociale-écologique est déjà là !
- Le modèle progressiste à venir sera-t-il social-démocrate ou social-écologique ?

