 La grande manifestation du 11 avril à Québec, la Marche Action Climat sera sans doute un moment fort du mouvement écologique pour forcer les pouvoirs publics à agir sur les changements climatiques. Dans la même direction mais par d’autres voies, au sein de la mouvance coopérative, mutualiste, associative et syndicale, un courant s’affirme depuis une décennie au Québec et dans le monde pour faire de la transition écologique de l’économie un impératif moral et sociopolitique.
La grande manifestation du 11 avril à Québec, la Marche Action Climat sera sans doute un moment fort du mouvement écologique pour forcer les pouvoirs publics à agir sur les changements climatiques. Dans la même direction mais par d’autres voies, au sein de la mouvance coopérative, mutualiste, associative et syndicale, un courant s’affirme depuis une décennie au Québec et dans le monde pour faire de la transition écologique de l’économie un impératif moral et sociopolitique.
Cette transition est au coeur d’un nouveau projet de société, au coeur de la construction d’un nouvel État social. Dans un premier billet sur l’État social (état des lieux), je faisais l’hypothèse qu’il traversait une étape critique de son histoire. Dans ce 2e billet, j’avance l’hypothèse que le 21e siècle sera peut-être le siècle d’une révolution écologique adossée à l’égalité sociale et à la transformation des dispositifs et des formes de la démocratie dans nos sociétés. Utopie ? Cela reste à voir ! Toutefois cela nécessitera d’intensifier la mobilisation – sur une longue période – pour inverser le rapport de forces actuel au Québec, au Canada et dans le monde. Quatre idées maîtresses guident ce billet : 1) la première concerne la mondialisation en cours qui profite surtout aux grands acteurs privés ; 2) la seconde porte sur l’écologie et la justice sociale comme socles d’un nouveau projet de société ; 3) la troisième a trait à l’économie coopérative et solidaire comme partie prenante de ce nouveau projet de société.
1. La mondialisation profite surtout aux grands acteurs privés, ces multinationales qui gouvernent le monde…et nos vies [1]
La mondialisation en cours depuis plus de deux décennies a d’abord été le moyen des plus puissants et tout particulièrement des multinationales de contourner les règles construites pendant les décennies antérieures dans les espaces nationaux au prix de longues luttes : celles pour une législation du travail et la reconnaissance du syndicalisme, pour le droit des consommateurs (législation coopérative et mutualiste), pour une protection sociale de base pour tous en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et ainsi de suite…Cette mondialisation a surtout creusé les inégalités et est en train de créer un immense gâchis écologique. Même le Forum économique mondial de Davos s’en inquiète comme le rapporte le journaliste Eric Desrosiers dans Le Devoir (17 janvier 2015).
…Les organisateurs du Forum économique mondial de Davos ont dévoilé, cette semaine, l’un de leurs rapports phares qui dressent chaque année, depuis 10 ans, le classement des principaux risques mondiaux en matière de probabilité et d’impact potentiel, selon 900 experts issus non seulement du monde des affaires, mais aussi des universités, des ONG, des gouvernements et des organisations internationales. « On assiste à un changement radical cette année, y constate-t-on. Pour la première fois de l’histoire de notre rapport, les risques économiques n’apparaissent que marginalement au sommet du classement…
…Le degré de danger attribué à ces risques typiquement économiques a graduellement été dépassé par celui des émissions de gaz à effet de serre, de la perte de biodiversité et des catastrophes climatiques…
Le résultat est là nous disent de nombreuses organisations syndicales, paysannes, coopératives et ONG sur le terrain au Nord comme au Sud : Aujourd’hui, nous dit par exemple une dirigeante de Terre solidaire (une importante ONG française), on donne des moyens aux firmes multinationales qui ont déjà tout. Les outils législatifs et financiers sont conçus pour elles. Alors qu’elles n’ont pas de problèmes de trésorerie et qu’elles ont accès au crédit. Elles bénéficient de soutiens juridiques, politiques et même diplomatiques… (Magasine FDM de Terre solidaire, septembre 2013).
De même l’aide publique au développement des pays du Sud a de plus en plus pour objectif de favoriser des multinationales par des investissements (miniers, pétroliers et autres) qui ne font que consolider ce qu’on pourrait appeler du développement forcé et extraverti. On est très loin de la prise en compte des besoins des communautés locales. Cette aide cautionne plutôt la course aux ressources (achat de terres, ressources d’approvisionnement en eau, minerais de tout acabit). Ce type de développement se fait au détriment du tissu économique productif local et de la PME et au détriment aussi bien sûr d’organisations paysannes et de petits producteurs, d’associations villageoises, de groupes de femmes transformatrices, d’entreprises collectives (coopératives, mutuelles et associations à caractère marchand) qui peinent à trouver une capitalisation propre et des politiques publiques qui leur sont favorables.
En d’autres termes le capitalisme de marché globalisé d’aujourd’hui n’améliore le sort que d’une minorité et creuse davantage les inégalités sociales. De plus le marché est particulièrement aveugle sur l’environnement car sa destruction ne lui coûte généralement pas beaucoup pour le moment, ce qui conduit à la surexploitation de ressources limitées.
2. Notre projet de société : le renouvellement de l’État social ne suffira pas!
Notre projet de société exige d’aller au delà du simple renouvellement de l’État social pour aller vers un État «social-écologique» tout en entrant simultanément dans la phase d’organisation d’une mondialisation durable.
Il faut siffler la fin de la récréation. Le dernier rapport des experts du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, est formel : il n’y a pas la moindre trace de modération dans le dérèglement climatique en cours. L’entrée dans un inconnu climatique nous fait courir un énorme risque dès 2030 nous disent ces experts. Il y a urgence écologique. Il faut donc travailler prioritairement à opérer une transition écologique massive dans tous les domaines : agriculture, énergie, transport, industrie, habitat…Et en premier lieu se défaire des énergies fossiles, augmenter considérablement la part des énergies renouvelables, aller vers une agriculture écologiquement intensive (transition agro-écologique, relocalisation des productions, valorisation des filières vivrières, des circuits courts et de l’agriculture urbaine), l’électrification des transports…
 Ce que vient encore de confirmer 60 experts canadiens dirigés par la biologiste Catherine Potvin dans leur rapport intitulé Agir sur les changements climatiques (Potvin et alii, 2015) Et, à coup sûr, sortir de la surconsommation dictée par un capitalisme ostentatoire qui capture les classes moyennes des pays du Nord et des pays émergents.
Ce que vient encore de confirmer 60 experts canadiens dirigés par la biologiste Catherine Potvin dans leur rapport intitulé Agir sur les changements climatiques (Potvin et alii, 2015) Et, à coup sûr, sortir de la surconsommation dictée par un capitalisme ostentatoire qui capture les classes moyennes des pays du Nord et des pays émergents.
Si les inégalités sociales sont bel et bien en montée, à l’intérieur des pays et encore plus entre le Nord et le Sud, on sait aussi que le risque n’est plus seulement social, il est devenu social-écologique (Laurent, 2014). En d’autres termes ces inégalités sociales nourrissent les crises écologiques et ces dernières en retour renforcent les inégalités sociales. Au 20e siècle, face aux risques, l’État-providence a inventé la solidarité sociale. Mais les risques ne sont plus uniquement de caractère social. Ils sont également écologiques (réchauffement climatique, pollutions diverses, perte de biodiversité…). La perspective, pour s’en sortir, nécessitera autre chose que de timides incursions dans le « vert ». Il faudra faire croître certains secteurs et faire décroître d’autres secteurs.
 Dans une entrevue accordée récemment à la revue Vie économique, Gérald Larose, président de la Caisse d’économie solidaire Desjardins et membre de la direction des Rencontres du Mont-Blanc (RMB), Forum international de dirigeants de l’économie sociale, affirmait en parlant du virage écologique de l’économie qui s’impose : Attention ! Nous ne sommes pas contre la croissance et pour la décroissance. C’est un débat mal posé ! La question est plutôt celle-ci : que faisons-nous croître et que faisons-nous décroître ? Jean Gadrey, économiste, se pose exactement la même question dans son livre Adieux à la croissance (2010) en dépit du titre trompeur de son ouvrage. Et James Galbraith, dans son plus récent livre (2015), arrive à des conclusions similaires en faisant valoir la pertinence d’une croissance lente dont les lignes directrices seraient «la primauté des petites banques sur les grandes, la hausse du salaire minimum, la décentralisation de l’économie, le renforcement de la protection sociale, la recherche de taux de rendement assez faibles mais soutenus» nous dit Michel Lapierre dans un résumé de son ouvrage compte tenu du monde dans lequel nous sommes maintenant, c’est-à-dire «soumis à la limitation des ressources et au changement climatique» (Devoir du 21mars 2015)
Dans une entrevue accordée récemment à la revue Vie économique, Gérald Larose, président de la Caisse d’économie solidaire Desjardins et membre de la direction des Rencontres du Mont-Blanc (RMB), Forum international de dirigeants de l’économie sociale, affirmait en parlant du virage écologique de l’économie qui s’impose : Attention ! Nous ne sommes pas contre la croissance et pour la décroissance. C’est un débat mal posé ! La question est plutôt celle-ci : que faisons-nous croître et que faisons-nous décroître ? Jean Gadrey, économiste, se pose exactement la même question dans son livre Adieux à la croissance (2010) en dépit du titre trompeur de son ouvrage. Et James Galbraith, dans son plus récent livre (2015), arrive à des conclusions similaires en faisant valoir la pertinence d’une croissance lente dont les lignes directrices seraient «la primauté des petites banques sur les grandes, la hausse du salaire minimum, la décentralisation de l’économie, le renforcement de la protection sociale, la recherche de taux de rendement assez faibles mais soutenus» nous dit Michel Lapierre dans un résumé de son ouvrage compte tenu du monde dans lequel nous sommes maintenant, c’est-à-dire «soumis à la limitation des ressources et au changement climatique» (Devoir du 21mars 2015)
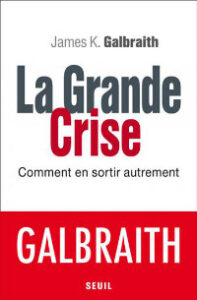 L’horizon obligé est celui de la « décroissance massive de notre empreinte écologique » nous dit l’économiste Alain Lipietz en annonçant du même coup une bonne nouvelle, à l’instar du mouvement syndical international, à l’effet que la décroissance en question nécessitera le quasi plein-emploi (Lipietz, 2012 : 81-89). Qu’on pense aux emplois dans le développement d’une agriculture biologique, dans le transport collectif [2], au déploiement élargi des services de proximité de caractère semi-public et semi-associatif en santé, au développement d’entreprises et d’emplois dans la distribution alimentaire de circuits courts, dans les énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermique) ou dans l’aménagement durable des forêts avec les perspectives qu’offre la biomasse ou encore aux emplois dans les entreprises de biométhanisation de nos déchets alimentaires, etc. Bref, contrairement à l’idée reçue, l’écologie est loin d’être l’ennemi de l’emploi.
L’horizon obligé est celui de la « décroissance massive de notre empreinte écologique » nous dit l’économiste Alain Lipietz en annonçant du même coup une bonne nouvelle, à l’instar du mouvement syndical international, à l’effet que la décroissance en question nécessitera le quasi plein-emploi (Lipietz, 2012 : 81-89). Qu’on pense aux emplois dans le développement d’une agriculture biologique, dans le transport collectif [2], au déploiement élargi des services de proximité de caractère semi-public et semi-associatif en santé, au développement d’entreprises et d’emplois dans la distribution alimentaire de circuits courts, dans les énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermique) ou dans l’aménagement durable des forêts avec les perspectives qu’offre la biomasse ou encore aux emplois dans les entreprises de biométhanisation de nos déchets alimentaires, etc. Bref, contrairement à l’idée reçue, l’écologie est loin d’être l’ennemi de l’emploi.
Les recherches économiques menées par le Millenium Institute dans 12 pays montrent que l’investissement de 2% du PIB dans l’économie verte peut suffire à créer jusqu’à 9,6 millions de nouveaux emplois par an dans les pays et les industries examinés. Le potentiel de création d’emploi et les perspectives d’emploi découlant des investissements verts, toutes nations et toutes industries confondues, sont considérables…… Les politiques, les réglementations et les placements financiers des gouvernements sont à même de générer les fonds destinés aux investissements. «Nous pouvons créer 48 millions d’emplois verts et décents sur cinq ans, et ce rien que dans 12 pays. Imaginez ce que nous pourrions faire dans 24 pays, imaginez dans 50 pays…» d’affirmer Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI (document de la Confédération syndicale internationale (CSI), Vers une croissance de l’emploi vert décent, avril 2012, Bruxelles).
Un État « social-écologique » : utopie mobilisatrice?
Les utopies peuvent être mobilisatrices. L’histoire sociale, dans le temps long, nous le confirme. Trois utopies l’ont été. Il y a d’abord eu celle des droits politiques et civiques qui ont pris leur envol avec la Révolution française (1789), mobilisation qui a, pour l’essentiel, traversé le 19e siècle. La bataille est toujours là mais les progrès enregistrés immenses.
Ensuite il y a eu celle des droits sociaux qui ont pris leur envol avec l’émergence du projet socialiste et du mouvement ouvrier comme locomotive (avec ses deux versants, le courant du « socialisme démocratique » et celui du « communisme »). Pays scandinaves comme référence pour le premier et l’Union soviétique comme référence pour le second. C’est la dominante du 20e siècle. Encore là, cette lutte sociale existe toujours. Et c’est le « socialisme démocratique » réalisé dans les pays scandinaves qui permet aujourd’hui à la planète entière de converger ou de rêver de converger vers une forme d’État social de ce type qui conjuguent avec succès efficacité économique et justice sociale.
« L’État social a été la véritable révolution économique du 20e siècle » nous dit l’économiste Christophe Ramaux (2012). C’est effectivement, dans l’après-guerre (1939-1945) que cette construction politique a pris forme dans un nombre important de pays d’Europe et en Amérique du Nord, construction qui doit beaucoup au plan intellectuel à Keynes et au plan politique à Roosevelt et à tous les forces de la social-démocratie de ce monde soutenus par leur mouvement ouvrier. Toutefois il ne faut pas que nous restions collés sur cet héritage pour lequel le défi central du 21e siècle – qui est le défi écologique – demeure encore un point aveugle comme je l’avais déjà avancé dans un article qui avait fait débat à une époque pas si lointaine (2010).
L’utopie mobilisatrice des dernières décennies est celle de l’écologie politique, l’utopie du 21e siècle. Quelque chose qui émerge et qui ressemble à ceci : un New Deal écologique et social comme il y a eu un New Deal social au 20e siècle fondé sur les conquêtes sociales du mouvement ouvrier. Pour le 21e siècle, c’est le mouvement écologique qui est en train de devenir une force motrice de notre avenir à tous.
Le 20e siècle a été le siècle d’un New Deal social, c’est-à-dire celui d’un État assureur contre les risques de la maladie, du chômage et de la vieillesse (assurance-santé, assurance-emploi, régimes de retraite). État qui répare les dégâts sociaux liés aux inégalités et développe la prévention permettant de se prémunir contre les risques. Au fondement de cet État social, la responsabilité des risques repose d’abord sur la collectivité, pas sur les individus.
Aujourd’hui, dans ce 21e siècle, l’État doit devenir l’assureur des risques climatiques qui croisent désormais étroitement les risques sociaux. Dans les pays du Nord, les riches peuvent se protéger eux-mêmes contre ces risques, pas les pauvres. Les pays riches peuvent se protéger eux-mêmes, pas les pays les plus vulnérables du Sud. Au 20e siècle, face aux risques, l’État-providence a inventé la solidarité sociale. Au 21e siècle, face aux nouveaux risques, l’État doit inventer une nouvelle solidarité car les crises écologiques (alimentaire, climatique…) laissées à elles-mêmes finissent toutes au même endroit : elle plombe la prospérité durable des régions affectées et des pays fortement touchés. D’où la nécessaire intégration de la cette dimension devenue centrale dans la protection sociale [3] .
Il faut donc imaginer une fiscalité qui, par exemple, déplacerait 10% à 20% de nos impôts vers la transition écologique de notre « vivre ensemble » tant au plan économique que social : agriculture et alimentation, énergie et transport, logement et santé, secteurs industriels en croissance, formation de la main d’oeuvre en provenance des secteurs en décroissance, etc.
Tout cela exige et exigera certainement une mobilisation de tous les mouvements et une intensification de la solidarité internationale. Cela nous amène au Québec à une réflexion nécessaire sur les priorités de la prochaine décennie et sur le contenu de ses priorités. Bref quelle est notre plate-forme commune? Ce qui précède fournit quelques ingrédients de départ de cette feuille de route qui est à configurer.
3. Le développement d’un vaste secteur non capitaliste avec l’économie coopérative et solidaire : une économie qui peut ouvrir une voie vers un État « social-écologique »
On l’a trop vite oublié mais les premières formes de protection sociale et de régulation des rapports de travail nous sont venues des mutuelles et des syndicats à partir du milieu du 19e siècle puis des mouvements de consommateurs organisés en coopératives…et ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui. Ce mouvement a préfiguré un autre modèle de développement où l’humanisme et la solidarité prévalaient. Ce mouvement a d’ailleurs constitué une des principales assises de l’État social dans le monde au 20e siècle et pourrait redevenir au 21e siècle une des assises d’un « État social-écologique » pour reprendre le concept innovateur de l’économiste Éloi Laurent (2014).
Les coopératives, les mutuelles et les associations de caractère marchand, comme secteur économique, pèsent aujourd’hui à l’échelle internationale pour 10% du PIB, 10% des emplois, 10% de la finance (BIT, 2011). Ce n’est pas rien. Cependant cette force relativement dispersée au plan économique doit davantage exercer son influence politique pour faire valoir de nouveaux cadres législatifs. Dans les deux dernières décennies, les lobbies des grands acteurs privés ont dominé la scène dans ce registre de l’influence. En contexte par surcroît d’États affaiblis par les principales composantes des grands acteurs privés, les grandes banques et les agences de notation.
 Certes, cette économie fondée sur la solidarité, coopératives en tête, n’a pas la capacité de remplacer ce que Ricardo Petrella nomme si justement l’« économie capitaliste de marché ». Elle peut cependant offrir une alternative et endiguer l’influence du modèle économique dominant dans plusieurs secteurs. N’est-ce pas ce qu’elles ont fait et font dans des secteurs comme la finance ou l’agriculture ! En occupant une part significative du marché de l’emploi, de la finance et du PIB dans un très grand nombre de pays de la planète (plus parfois comme c’est le cas des pays scandinaves), ces entreprises collectives peuvent en modifier sérieusement la structure de base. Il y a cependant des conditions sociopolitiques bien concrètes: 1) l’intercoopération (pour sortir du travail en silos) ; 2) le soutien des mouvements à ce type d’économie qui ne spécule pas, qui est démocratique et qui ne produit généralement que de l’utile ; 3) l’élaboration de positions communes et des convergences entre mouvements pour peser ensemble sur les pouvoirs en place (États et institutions internationales). Ricardo Petrella résume bien la situation :
Certes, cette économie fondée sur la solidarité, coopératives en tête, n’a pas la capacité de remplacer ce que Ricardo Petrella nomme si justement l’« économie capitaliste de marché ». Elle peut cependant offrir une alternative et endiguer l’influence du modèle économique dominant dans plusieurs secteurs. N’est-ce pas ce qu’elles ont fait et font dans des secteurs comme la finance ou l’agriculture ! En occupant une part significative du marché de l’emploi, de la finance et du PIB dans un très grand nombre de pays de la planète (plus parfois comme c’est le cas des pays scandinaves), ces entreprises collectives peuvent en modifier sérieusement la structure de base. Il y a cependant des conditions sociopolitiques bien concrètes: 1) l’intercoopération (pour sortir du travail en silos) ; 2) le soutien des mouvements à ce type d’économie qui ne spécule pas, qui est démocratique et qui ne produit généralement que de l’utile ; 3) l’élaboration de positions communes et des convergences entre mouvements pour peser ensemble sur les pouvoirs en place (États et institutions internationales). Ricardo Petrella résume bien la situation :
… Le point clé est de savoir si les promoteurs du modèle coopératif pensent que le système économique qui domine aujourd’hui – l’économie capitaliste de marché – est réellement en crise… Si les coopératives prennent acte que le système capitaliste de marché – qui a conduit à la situation humaine et sociale dramatique de ces dernières années et aux dévastations de la planète Terre que l’on connait – est en échec structurel et qu’il ne répond plus aux besoins de l’humanité, on pourrait alors assister à l’émergence d’une nouvelle forme de coopératives qui organiseraient la production de la richesse, notamment collective, par la promotion des biens communs et la prestation des services publics d’intérêt général indispensables au « vivre ensemble »…Source : Sommet international des coopératives, Québec, octobre 2012.
Voilà pourquoi certaines organisations de caractère international, issues des mouvements sociaux de ce 20e siècle, bougent et cherchent à se renouveler par les temps qui courent. C’est le cas de l’Alliance coopérative internationale (ACI), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de nouvelles initiatives internationales comme l’association des Rencontres du Mont-Blanc (un Forum de dirigeants mutualistes et coopératifs), l’INAISE (l’association internationale de la finance solidaire), des organisations paysannes et des réseaux internationaux de coopération au développement (des agri-agences comme AgriCord ou le réseau syndical Coopération au développement de la CSI) de même que des initiatives comme le Sommet international des coopératives. Elles sont précieuses dans la mobilisation pour une mondialisation durable parce qu’elles peuvent soutenir les initiatives locales à se fédérer et donc à prendre de la force [4] .
|
Que faire pour sortir de cette impasse ? Selon Gérald Larose, cela passe par trois champs d’action. D’une part, il faut favoriser le renforcement systématique de la société civile dans la conduite des affaires économiques. « Cette économie-là est conduite par les communautés, par les groupes, et elle est démocratique et solidaire. C’est une économie qui est régionale ou locale et qui est pilotée par des collectivités. » D’autre part, il faut redonner à l’État ses responsabilités en matière de régulation. « On l’a systématiquement discrédité, à tort, sous prétexte que l’économie appartient au secteur privé. Au contraire, il incombe à l’État de veiller au bien commun et, en ce sens, il a voix au chapitre. » Enfin, il faut agir au niveau international. « On doit, sur le plan international, muscler les organisations de cet ordre dans leurs responsabilités de concertation et de convention de manière à recréer la régulation et la réglementation à cet échelon. C’est difficile à réaliser, mais on n’a pas le choix. » Gérald Larose, 22 mai 2013, entrevue du journal Le Devoir par Réginald Harvey. |
On ne le sait pas assez , il y a des organisations dans la mouvance coopérative et syndicale internationale qui posent de plus en plus un diagnostic sévère mais très juste à l’effet que les entreprises collectives (coopératives, mutuelles et associations) sont une force économique mais également un éternel nain politique. Conclusion pour faire court : les coopératives, mutuelles et entreprises associées doivent intervenir sur la place publique dans le cadre démocratique d’un débat ouvert pour faire avancer de nouvelles législations d’intérêt général. Un bel exemple de cela nous est fourni par Co-operative Energy au Royaume-Uni.
Prenons l’exemple de Co-operative Energy. Dès ses débuts, l’entreprise s’est engagée à offrir des prix justes et a promis que la teneur en carbone de son électricité ne dépasserait jamais la moitié de la moyenne nationale. En plus d’appuyer l’utilisation de sources d’énergie renouvelable, elle a également encouragé les initiatives communautaires de production d’énergie.
Toutefois, Ben Reid (chef de la direction de Midcounties, dont fait partie Co-operative Energy) et Ramsay Dunning (directeur général de Co-operative Energy) ont rapidement constaté à quel point il serait difficile d’attirer des clients et de gagner des parts de marché devant les « six géants de l’énergie », qui contrôlaient 97 % de l’approvisionnement énergétique au Royaume-Uni et profitaient d’un cadre réglementaire ayant évolué en leur faveur.
« À titre de coopérative, notre rôle sur le marché n’est pas de jouer le jeu, ni même de gagner, mais bien de redéfinir les règles du jeu (« changing the game » », de dire M. Reid, avant que M. Dunning ne souligne « la nécessité de remanier de fond en comble la politique énergétique et de supprimer sans tarder la production d’électricité à partir du charbon ». C’est dans cette optique qu’ils ont élaboré une stratégie de lobbying d’une grande efficacité, comme en témoigne le plus récent rapport sur la responsabilité sociale de Co-operative Energy. Source : Infolettre du Sommet et Co-operative News, 5 juin 2014 dans un texte intitulé « Co-operative lobbying : seeking change for good ».
Conclusion
Sans, pour autant, faire tomber de son cheval, « le cavalier fou du capitalisme financier », ces organisations avancent qu’il est possible d’infléchir l’économie dans la perspective d’un développement économique viable, socialement équitable et écologiquement durable. Le constat est lucide : les initiatives de ces entreprises peuvent être un levier non seulement pour sortir de la crise actuelle mais pour fournir une partie des assises à cet État «social-écologique». Toutefois elles ne peuvent le faire seules. Elles le peuvent avec d’autres mouvements et elles se doivent de mobiliser à toutes les échelles d’intervention du local à l’international. Déjà au Québec la conférence internationale de Lévis en 2010 avait permis d’ouvrir cet horizon de même que le Rendez-vous de la Caisse d’économie solidaire de 2012 (débats repris dans Favreau et Molina, 2011 et dans Favreau et Hébert, 2012) sans compter une partie des débats des deux éditions du Sommet international des coopératives (2012 et 2014) de même que celles des Rencontres du Mont-Blanc de 2011 et 2013.
Pour en savoir plus
1) Un numéro de la revue Vie économique sur la transition énergétique. Parution le mois prochain.
Vol. 6, no 2 (mai 2015)
Évitons la catastrophe : agir maintenant pour la transition énergétique
Un dossier réalisé par Gilles Bourque, Louis Favreau et François L’Italien. Pour stimuler le débat public sur la pertinence de souscrire à un grand projet de transition vers une économie durable, la Revue Vie économique fait le point sur les divers enjeux et offre avec ce numéro une tribune à un ensemble de chercheurs et de praticiens.
2) Un rapport de 60 chercheurs canadiens dirigé par la biologiste Catherine Potvin de l’Université McGill
Potvin, C. et alii (2015) Agir sur les changements climatiques. Dialogues pour un Canada vert.
Le document, intitulé « Agir sur les changements climatiques : solutions des chercheurs canadiens », conclut que le Canada doit se donner comme objectif de réduire de 80 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES), et ce, d’ici 2050. Le document précise le train de mesures à prendre pour y arriver.
Références
- Bourque, G., L. Favreau et E. Molina (2012), Le capitalisme en crise. Quelle réponse des coopératives ? Revue Vie économique, Montréal, juin 2012. http://www.eve.coop/?r=15
- Cahier spécial du Devoir (2014), Les coopératives, fer de lance de l’économie verte, 2 octobre 2014 http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2014-10-02/cooperatives
- Favreau L. et M. Hébert (2012), La transition écologique de l’économie, PUQ, Québec. http://puq.ca/catalogue/livres/transition-ecologique-economie-2414.html
- Gagnon, D. (2015), Syndicats et coopératives : quelles alliances au plan international ? CRDC, Université du Québec en Outaouais http://jupiter.uqo.ca/ries2001/carnet/spip.php?article102
- Gadrey, J. (2010), Adieux à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire. Éd. Les petits matins, Paris
- Galbraith, James K. (2015), La Grande Crise. Comment en sortir autrement. Éd. du Seuil, Paris.
- Gélinas, J. (2015), Le néolibre-échange (et le coopérativisme comme modèle d’avenir). Éd.Écosociété, Montréal.
- Laurent, É. (2014), Le bel avenir de l’État Providence, Éd. Les liens qui libèrent, Paris.
- Lipietz, A. (2012), Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste. La Découverte, Paris.
Ramaux, C. (2012), L’État social, pour sortir du chaos néolibéral. Fayard, Paris.
[1] On peut lire à ce propos deux courts articles que j’ai écrit pour le blogue Oikos sur Ces multinationales qui gouvernent nos vies http://www.oikosblogue.coop/?p=15535
[2] Une étude européenne démontre que la suppression de 4,5 millions d’emplois dans la production de voitures individuelles en créerait en revanche 8 millions dans les transports collectifs (Canfin, 2009).
[3] L’État social n’est pas réductible au risque et à la protection sociale de base. C’est un raccourci. Au sens plein du terme l’État social a trait à la protection contre les risques (maladie, chômage, vieillesse…), aux rapports de travail, au développement et à l’organisation des services publics et aux politiques économiques (emploi, développement régional…)
[4] Voir à ce propos l’expérience internationale de la FTQ racontée par Denise Gagnon, responsable de la solidarité internationale au sein de cette centrale http://jupiter.uqo.ca/ries2001/carnet/spip.php?article102
Louis Favreau
Articles de cet auteur
- Solidarité internationale en temps de pandémie : pompiers de service ou architectes du développement ?
- Développement économique local dans les pays du Sud : l’avenir des services énergétiques
- Solidarité internationale et développement des communautés à l’heure de l’urgence climatique
- Agriculture au Québec et dans le monde : la transition sociale-écologique est déjà là !
- Le modèle progressiste à venir sera-t-il social-démocrate ou social-écologique ?



