Rio+20 : enjeux et défis mondiaux du développement durable
Dans une entrevue accordée récemment à la revue Vie économique (à paraître début juin www.eve.coop), Gérald Larose, président de la Caisse d’économie solidaire Desjardins et membre de la direction des Rencontres du Mont-Blanc (RMB), nouveau Forum international de dirigeants de l’économie sociale affirmait, parlant du virage écologique de l’économie qui s’impose : « Attention ! Nous ne sommes pas contre la croissance et pour la décroissance. C’est un débat mal posé ! La question est plutôt celle-ci : que faisons-nous croître et que faisons-nous décroître ? ». Jean Gadrey, économiste, se pose exactement la même question dans son livre Adieux à la croissance (2010) en dépit du titre trompeur de son ouvrage.
Alain Lipietz, économiste et écologiste, va plus loin encore dans un article du même numéro de la revue Vie économique, « non seulement l’Humanité a les moyens de répondre à la double crise écologique, mais la réponse à la crise écologique est une réponse à la crise économique…Ce n’est pas en essayant de gratter les derniers hydrocarbures qui se cachent dans les dernières bulles des dernières feuilles de schiste…. La Confédération Européenne des Syndicats (CES) évalue qu’un programme visant à diminuer la production de gaz à effet de serre de 30% d’ici 2020 entrainera 4.5 millions d’emplois en moins dans la production de voitures individuelles, mais 8 millions d’emplois en plus dans la production de transports en commun, soit donc la création, nette, de 3.5 millions d’emplois ! »
À coup sûr, une nouvelle conviction s’installe à demeure : il faut revisiter le développement car le défi écologique auquel nous faisons maintenant face met bien en évidence la finitude de notre monde. Et du coup s’impose également la nécessité de transformer le modèle économique dominant qui nous a amené à la crise que nous traversons. Le débat sur le développement ne date pas d’hier : depuis près de 50 ans la notion de développement fait l’objet d’importants débats et de visions fort différentes voire opposées au sein des institutions internationales. Il fait l’objet d’un aussi long parcours au sein des OCI et des mouvements sociaux. Après l’échec fortement ressenti des coopérations étatiques des pays capitalistes du Nord dans le Sud et celui décevant des mouvements de libération nationale et de leur modèle « développementiste », qu’est-il resté ? Le concept a été mis à mal : ramené par le FMI et la Banque mondiale à une simple question de croissance du produit intérieur brut (PIB) et par les institutions plus sociales de l’ONU à une lutte contre l’extrême pauvreté (OMD). Pour d’autres, l’idée même du « développement » s’est réduite à une simple croyance occidentale. Faut-il succomber à ce réductionnisme d’une part et d’autre part à ce relativisme économique et culturel ?
Un autre éclairage est possible ! Nous ne sommes pas condamnés à la croissance au sens productiviste, c’est-à-dire produire toujours plus sans égard aux écosystèmes de la planète. Il y a cependant quelque chose comme un droit au développement dans tous les pays et surtout au Sud : droit à l’emploi, ce qui suppose des économies locales, des entreprises, de la croissance dans différents secteurs (pas seulement de la survie et de la subsistance) ; des droits sociaux (écoles, services de santé, services publics de proximité..) liés au développement d’États dignes de ce nom et donc des impôts et des taxes tirés des entreprises et des salariés qui y travaillent…En fait la question n’est-elle pas plutôt comme le disent Larose, Gadrey et Lipietz : quoi faire croître et quoi faire décroître ? Reconstitution d’un itinéraire sur une période longue, soit des années 1960 à 2010.
 En moins de 50 ans, nous sommes passés de la décolonisation, – la notion de développement servant alors de référence quasi-universelle dans les deux blocs (capitaliste et communiste) – à une mondialisation ultralibérale à partir des années 90. Ce début de basculement du monde a provoqué du désenchantement dont le point culminant est l’abandon, à toute fin pratique, du thème du développement durant cette décennie, simultanément à l’effondrement du Bloc soviétique. La seule perspective présente a alors été celle des droits de l’Homme et plus largement la montée de l’humanitaire devenu la principale finalité légitime dans les rapports entre nations par ces temps d’incertitude. Avec l’an 2000 la grande initiative des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) nous offre l’exemple sur plus de 10 ans d’une intervention marquée par l’humanitaire. Mais si cela se passe de cette manière dans les institutions internationales, il en va néanmoins autrement dans les OCI, du moins celles qui se sont toujours définies comme des ONG de développement (ONGD).
En moins de 50 ans, nous sommes passés de la décolonisation, – la notion de développement servant alors de référence quasi-universelle dans les deux blocs (capitaliste et communiste) – à une mondialisation ultralibérale à partir des années 90. Ce début de basculement du monde a provoqué du désenchantement dont le point culminant est l’abandon, à toute fin pratique, du thème du développement durant cette décennie, simultanément à l’effondrement du Bloc soviétique. La seule perspective présente a alors été celle des droits de l’Homme et plus largement la montée de l’humanitaire devenu la principale finalité légitime dans les rapports entre nations par ces temps d’incertitude. Avec l’an 2000 la grande initiative des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) nous offre l’exemple sur plus de 10 ans d’une intervention marquée par l’humanitaire. Mais si cela se passe de cette manière dans les institutions internationales, il en va néanmoins autrement dans les OCI, du moins celles qui se sont toujours définies comme des ONG de développement (ONGD).
L’itinéraire de la notion de développement dans les OCI des années 1960 à aujourd’hui
En fait nous sommes passés, au sein des organismes de coopération internationale (OCI), de la thématique du « développement-libération » à celle du « développement-conversion écologique de l’économie ». Quel est ce parcours ? Présentation en cinq temps !
1. Les années 1960 : la décennie de la lutte contre la faim dans les pays dits du Tiers-monde
À cette époque, le développement, c’est d’abord et avant tout tenter de vaincre la faim, c’est-à-dire nourrir l’humanité. Mais cela implique de lutter contre ceux qui s’opposent à la commercialisation des produits du « Tiers-Monde » comme il était dit du Sud durant cette décennie. La conception prévalente de l’aide aux pays du Sud conçue comme simple relation d’assistance en prend alors un coup. Une lutte est donc à mener.
2. Les années 1970 : la décennie d’un développement global où tout est politique
Le développement, c’est la libération intégrale par la transformation des structures de production, par l’établissement de nouveaux rapports sociaux dans une optique de transformation globale. Il faut donc aller jusqu’à investir la dimension politique du développement. On entre alors, avec cette décennie, dans une période de radicalisation qui s’inscrit dans la mouvance d’organisations, de mouvements et de partis politiques de gauche. La solidarité internationale est animée par l’impératif de soutien des OCI à cette nébuleuse de mouvements.
3. Les années 1980 : les modèles alternatifs de développement perdent leur pouvoir d’attraction
Avec l’expérience de la décennie précédente, nous avions appris que le développement supposait des changements structurels. La décennie 80 voit plutôt émerger une période de crise des modèles alternatifs voulant s’attaquer à ces changements structurels. Par exemple la Tanzanie de Nyerere ou le Nicaragua des Sandinistes ne vont pas convaincre beaucoup de monde. Il y a aussi et surtout l’effet rebond des déficits démocratiques manifestes des régimes dits «socialistes» (dirigés par des partis communistes) comme la Chine, Cuba ou le Vietnam devenus des régimes autoritaires. L’approche du développement devient alors moins idéologique, moins branchée sur la dénonciation du modèle dominant et l’espoir lié à des modèles de référence. Dans nombre d’OCI, c’est le retour au développement des communautés, le retour de l’intervention locale et l’espoir retrouvé de la microfinance, du commerce équitable, des coopératives communautaires en milieu rural, des associations citoyennes dans les bidonvilles, etc.
4. Les années 1990 : la notion de développement entre en crise profonde
La notion même de développement est en crise. D’un côté, des modèles d’État qui avaient servi de référence sont en faillite (le Mur de Berlin en est l’expression symbolique par excellence) et, de l’autre, la multiplication de petits projets consolidant des communautés locales. Mais il devient vite avéré que cette intervention à l’échelle micro ne peut vaincre le sous-développement. C’est le sommet de la Terre de Rio en 1992 qui ouvre la porte du développement durable et met sur l’avant-scène internationale le caractère global des enjeux écologiques de notre planète.
5. Les années 2000 : la mondialisation néolibérale entre en force
Les Dragons et les Tigres d’Asie (Indonésie, Thaïlande…) s’écrasent, la finance capitaliste passe progressivement aux postes de commande à l’échelle internationale, le FMI et la Banque Mondiale font déjà depuis un moment la pluie et le beau temps, etc. Sauf que… ! Un grand rassemblement à Seattle en 1999 devient le signe annonciateur d’une société civile internationale émergente. Le Forum social mondial (FSM) se réunit pour une première fois en 2001 à Porto Alegre au Brésil. C’est le début de quelque chose qui ne cessera pas de progresser pendant toute la décennie, à tâtons certes, mais sans perdre son élan initial (Voir mon billet précédent ). À partir de là, le développement s’identifie davantage comme une réponse à des besoins et comme une promotion de l’accès à des droits pour les populations du Sud. L’inédit et le saut qualitatif : avec l’arrivée du FSM, un décloisonnement des luttes (jusque là trop sectorielles) et un changement d’échelle (depuis trop longtemps repliées sur le local) ; la justice climatique y fait son chemin vers un développement désormais considéré comme «un bien vivre» fondé sur un idéal de sobriété face à la finitude du monde à laquelle nous expose les risques climatiques et les dégradations des conditions de vie dans nombre de régions du monde. Bref, nous entrons dans l’ère de la conversion écologique de l’économie.
La notion de développement dans les institutions internationales aujourd’hui : l’entrée en scène de l’économie verte
Les espoirs de la décolonisation passés (les années 1960 et 1970), le « développementisme » par la reprise des modèles industriels à la manière capitaliste des pays du Nord ou à la soviétique ayant épuisé les dernières balles de leurs fusils (années 1980), l’entrée en scène des programmes d’ajustement structurel (PAS) du FMI et de la BM ayant laminé tous les fondamentaux d’États sociaux émergents au Sud (santé, éducation, services sociaux…) pendant les années 1990, la première décennie du 21e siècle s’ouvre sur l’humanitaire (les Objectifs du millénaire pour le développement) mais aussi sur le développement durable. On aboutit aujourd’hui, au seuil de Rio+20, à l’émergence de la notion d’économie verte.
En ce qui a trait au développement par l’humanitaire, les OMD deviennent les incontournables lignes de force de la lutte internationale contre la pauvreté dans laquelle l’ONU saura mobiliser un nombre impressionnant d’OCI (ou d’ONG). Si les premières années de cette mobilisation canalisent les énergies de presque toutes les institutions internationales et d’un nombre considérable d’ONG, les objectifs de ce discours obligé apparaîtront dépourvus de moyens mais surtout {{dépourvus de capacité de s’attaquer aux inégalités qui sous-tendent cette pauvreté.}} Programmés sur 15 ans, les OMD supposent des progrès d’une telle rapidité que d’aucuns vont affirmer avec raison qu’il n’y a pas de précédent historique en la matière. Cela s’explique fort bien si on prend deux exemples : le Mali en Afrique de l’Ouest et l’Inde en Asie du Sud-Est.

Dans le premier cas, deux millions de Maliens gagnent leur vie dans la filière du coton. Or, le marché international est sous l’emprise du coton américain et européen. Le Mali n’arrive pas à bien écouler son coton sur le marché. Précarité comme horizon dans une jeune démocratie dont la volonté de développement et de démocratisation jusqu’à récemment (soit plus de 20 ans) aura été particulièrement manifeste sinon exemplaire. La principale cause, ce sont les structures du commerce international. Si on ne touche pas aux règles du jeu du commerce international, comment vaincre la pauvreté dans ce pays ?
Dans le second cas, en Inde, les « intouchables » (25 % de la population de ce pays d’un milliard d’habitants) forment les « basses classes » d’une société qui, en dépit de sa démocratie, – la plus vieille des pays du Sud (1947)- , n’a pas réussi à éliminer son système de castes, lequel leur interdit l’accès à nombre d’emplois et de services de base. Dans ce cas, derrière la pauvreté, il y la discrimination d’un système de castes. La question centrale devient donc : « lutte contre la pauvreté » ou combat contre les inégalités sociales et donc pour la démocratie et un autre modèle de développement ?
Bref, les OMD font plutôt figure d’initiatives humanitaires qui ne débouchent pas sur un véritable développement. Quelle direction prendre alors? Cette question est encore plus impérative à l’heure où la prise de conscience de la gravité du risque écologique a progressé à vive allure mais que, par ailleurs, d’importants pays émergents – comme la Chine, l’Inde et le Brésil -, se sont lancés dans une dans une course folle aux ressources naturelles. Ce qui ne fait qu’accentuer le désastre annoncé. Peut-on alors compter sur un New Deal pour sortir de la crise actuelle puisque, du point de vue strictement macro-économique, elle est pratiquement la même que celle de 1930 ? « Eh bien non, justement pas, de dire Alain Lipietz, parce que, aujourd’hui, si vous vendiez une voiture à tous les Chinois et à tous les Indiens, comme le proposait Henry Ford dans les années 1920 pour écouler son immense production, alors, selon le mot de Gandhi, ces deux pays à eux seuls « dévoreraient la planète comme une invasion de sauterelles ». Il ne suffit pas d’un New Deal, il nous faut un Green Deal » (Lipietz dans Vie économique, juin 2012).
Les grandes institutions internationales sont en partie sorties de l’idéologie productiviste en établissant enfin une distinction majeure entre la croissance qui implique une augmentation continue de la production et le développement qui consiste en l’organisation de la consommation et de la production, des revenus et des dépenses en fonction de l’amélioration des conditions et de la qualité de vie des populations : l’emploi, l’habitat, l’éducation, la santé…. Dans les années 1990, c’est grâce à des économistes du Sud qui ont introduit un indice composite dont les trois principaux éléments sont l’espérance de vie à la naissance, le niveau d’instruction et le niveau de revenu. Cet indice de développement humain (IDH) est, depuis près de 20 ans, le point de repère du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD). Une véritable petite révolution : la porte de la pluridimensionnalité du développement a été ouverte. Plutôt que de congédier la notion de développement, plusieurs travaux lui ont redonné sens en combinant l’économique, le social et l’environnement. La dernière décennie (2000-2010) a poussé plus loin encore la perspective de fournir des indicateurs de richesse plus adéquats sous la poussée du défi écologique.
Une des grandes impensées politiques de la dernière décennie a donc été la lutte contre les inégalités. Néanmoins le mur avait une brèche: l’entrée en scène de la notion de développement durable qui ouvre, bien que de façon diffuse, une réponse aux enjeux actuels parce qu’elle intègre sans détour les défis économiques, climatiques, énergétiques, alimentaires notamment au chapitre des coûts de transport, de l’efficacité énergétique, de la relocalisation des productions, etc. Dans cette foulée, la notion de biens publics traverse la dernière décennie (Petrella, 2012). Cette notion fait valoir que des secteurs essentiels comme les ressources naturelles, l’eau, l’alimentation, la santé, l’éducation doivent échapper au jeu international de la finance parce qu’ils constituent des biens publics. La régulation politique des États doit imposer cela au marché parce que la croissance qu’il induit ne génère pas par elle-même d’égalité. Ces solutions de rechange au néolibéralisme mondialisé se concrétisent-elles? Depuis Rio 1992, peu d’engagements ont été respectés et les attentes pour Rio+20 sont au plus bas nous disait Brice Lalonde, le coordonnateur exécutif du Sommet Rio+20, aux RMB en novembre dernier :
« Le Sommet de Rio, ce sera 194 pays et 50,000 personnes représentant des associations, des villes et cités, des syndicats, des entreprises…non pas surtout pour faire le bilan des 20 dernières années mais plutôt de voir ce que nous allons faire dans les 20 prochaines années. Et pour la première fois, il n’y a pas de leadership. Les pays émergents ne veulent pas se risquer parce qu’ils pourraient perdre le capital de sympathie des pays les plus pauvres qui pourraient s’inquiéter. Les pays riches se neutralisent mutuellement. En fait, c’est plutôt, au plan de la géopolitique internationale, l’éclatement général ». Cependant il y a 660 soumissions (et 5 000 pages de texte) en provenance d’États et de la société civile. Mais le risque viendra du monde des grandes multinationales, particulièrement les minières, les gazières et les pétrolières qui ne manqueront pas de peser de tout leur poids.
[http://www.oikosblogue.coop/?p=9647->http://www.oikosblogue.coop/?p=9647]
Développement durable : une percée significative dans les institutions et les mouvements
C’est à l’initiative du mouvement écologique qu’a surgi ce que certains qualifient être la « plus grande percée conceptuelle de la fin du XXe siècle », le développement durable. L’exigence intergénérationnelle introduite par la notion de développement durable a en effet eu de fortes retombées. Portée par nombre d’ONGI et forgée au sein de grandes institutions internationales de caractère culturel (UNESCO) ou social (Rapport Bruntland en 1987, Sommet de Rio en 1992), l’expression s’est diffusée dans plusieurs États, dans les gouvernements locaux, dans la communauté scientifique. Elle déborde aujourd’hui les organisations et mouvements spécialisés dans l’écologie pour être réappropriée par d’autres mouvements et institutions. L’usage des ressources naturelles selon le principe de précaution –le travail de la communauté, par la communauté et pour la communauté– est désormais à l’ordre du jour. Ce principe est aujourd’hui porté par de nombreuses ONG et plus généralement par les milieux paysans, coopératifs, associatifs et syndicaux.
Un rôle plus déterminant des facteurs écologiques s’est imposé à tous au lendemain de l’échec de Copenhague en 2009 sur les enjeux du climat. De ce côté-là les choses sont claires. Mais ce qui est aussi clair, c’est qu’il s’agit d’un rapport de forces mondial dans lequel il ne suffit pas d’agir localement (le développement autocentré ou endogène) et de penser globalement. Il faut aussi agir globalement. Ce qui implique beaucoup de choses, telle l’annulation de la dette des pays les plus pauvres, le développement sans précédent d’un commerce international de produits écologiquement sains dont le commerce équitable est une amorce, la protection internationale de la biodiversité par un organisme international doté de pouvoirs afférents, etc. Il s’agit donc bien d’une action collective de longue haleine car les opposants, s’ils ne sont pas nécessairement nombreux, sont très puissants, très bien organisés et très influents, notamment les lobbies des pétrolières, des gazières, des minières et des fournisseurs mondiaux d’intrants dans le secteur de la production agricole pour ne nommer que ceux-là. C’est là le défi de ce 21e siècle qui commence http://www.oikosblogue.coop/?p=10760
 Dans ce sens, le projet de New Deal écologique agit comme une nouvelle utopie, faisant référence à une entente générale entre les États visant un développement durable mais cette fois-ci à l’échelle mondiale. Si le 20e siècle a vu surgir un « New Deal » entre le capitalisme et le mouvement ouvrier, ouvrant ainsi une série de compromis qui ont sorti les pays du Nord du capitalisme sauvage aux bénéfices de régulations sociales, alors ce « New Deal » du 21e siècle n’est peut-être pas une douce folie. Il induit cependant la nécessité d’une très forte mobilisation des mouvements sociaux sur l’urgence écologique, c’est-à-dire une mobilisation trouvant des réponses fortes aux questions suivantes : peut-on laisser le système financier en l’état ? Peut-on laisser les grands actionnaires dicter leurs quatre volontés par leur politique du gain à court terme ? Peut-on laisser le commerce mondial développer des échanges aussi peu écologiques en matière de transport de marchandises en se satisfaisant uniquement de gestes écologiquement exemplaires? Peut-on laisser courir le recours systématique au crédit, à la publicité sans contraintes, à l’emprise des marques, à la pression au renouvellement constant des biens que nous possédons, bref le consumérisme croissant qui a fait prendre nos désirs pour des besoins et le futile pour de l’utile? Peut-on tolérer encore longtemps des États qui ont des politiques de laisser-faire face à l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles et notamment des ressources énergétiques fossiles (la dernière en liste, le gaz de schiste), l’exploitation intensive de terres agricoles à des fins énergétiques (ce qui menace la biodiversité), l’utilisation des terres arables à d’autres fins (grands centres d’achat, espaces pour le parc automobile au Nord, terres pour produire des agrocarburants au Sud) ? Peut-on laisser une agriculture productiviste continuer à utiliser massivement des intrants chimiques et des pesticides en polluant les nappes phréatiques et les cours d’eau, à augmenter la distance entre la production agricole à grande échelle et les lieux de transformation et de consommation, etc. ? (Document d’orientation des RMB 2011)
Dans ce sens, le projet de New Deal écologique agit comme une nouvelle utopie, faisant référence à une entente générale entre les États visant un développement durable mais cette fois-ci à l’échelle mondiale. Si le 20e siècle a vu surgir un « New Deal » entre le capitalisme et le mouvement ouvrier, ouvrant ainsi une série de compromis qui ont sorti les pays du Nord du capitalisme sauvage aux bénéfices de régulations sociales, alors ce « New Deal » du 21e siècle n’est peut-être pas une douce folie. Il induit cependant la nécessité d’une très forte mobilisation des mouvements sociaux sur l’urgence écologique, c’est-à-dire une mobilisation trouvant des réponses fortes aux questions suivantes : peut-on laisser le système financier en l’état ? Peut-on laisser les grands actionnaires dicter leurs quatre volontés par leur politique du gain à court terme ? Peut-on laisser le commerce mondial développer des échanges aussi peu écologiques en matière de transport de marchandises en se satisfaisant uniquement de gestes écologiquement exemplaires? Peut-on laisser courir le recours systématique au crédit, à la publicité sans contraintes, à l’emprise des marques, à la pression au renouvellement constant des biens que nous possédons, bref le consumérisme croissant qui a fait prendre nos désirs pour des besoins et le futile pour de l’utile? Peut-on tolérer encore longtemps des États qui ont des politiques de laisser-faire face à l’intensification de l’exploitation des ressources naturelles et notamment des ressources énergétiques fossiles (la dernière en liste, le gaz de schiste), l’exploitation intensive de terres agricoles à des fins énergétiques (ce qui menace la biodiversité), l’utilisation des terres arables à d’autres fins (grands centres d’achat, espaces pour le parc automobile au Nord, terres pour produire des agrocarburants au Sud) ? Peut-on laisser une agriculture productiviste continuer à utiliser massivement des intrants chimiques et des pesticides en polluant les nappes phréatiques et les cours d’eau, à augmenter la distance entre la production agricole à grande échelle et les lieux de transformation et de consommation, etc. ? (Document d’orientation des RMB 2011)
En guise de conclusion : pas de développement sans croissance
Le moindrement qu’on touche à l’économie, dans son sens le plus substantiel, nous parlons de ce dont nous avons besoin pour vivre. Et non pas ce qui apparaît comme sa face la plus visible, celle du modèle dominant, guidé, voire commandé par l’intérêt, le calcul, l’appât du gain. L’expérience des coopératives depuis 150 ans tout comme celle de l’ensemble de l’ESS (les entreprises de caractère collectif), l’action collective de tous les mouvements de même que la régulation politique démocratique apportée par les États sont et seront au cœur de ce processus (Favreau et Molina, 2011).
 L’économie de survie et l’économie de subsistance qui constituent toutes deux une bonne partie de l’économie des pays du Sud, souvent même une très grande partie, si on pense à l’Afrique, ne satisfont aucune communauté ou groupe parmi les plus concernés. Car ces économies fonctionnent à la débrouille, de façon très inégale d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. Il faut donc organiser l’économie en fonction de l’ensemble de la population.
L’économie de survie et l’économie de subsistance qui constituent toutes deux une bonne partie de l’économie des pays du Sud, souvent même une très grande partie, si on pense à l’Afrique, ne satisfont aucune communauté ou groupe parmi les plus concernés. Car ces économies fonctionnent à la débrouille, de façon très inégale d’un pays à l’autre et d’une région à l’autre. Il faut donc organiser l’économie en fonction de l’ensemble de la population.
La croissance est, dans cette perspective, nécessaire au développement. Cela veut dire : des investissements (assurer la capitalisation des entreprises) ; l’émergence d’entreprises (la production de biens et de services qui répondent aux besoins essentiels) ; des emplois et donc des salaires ou, en tout état de cause, des revenus pour les familles (travail autonome de l’économie populaire). Mais si la croissance est trop liée à une économie capitaliste de marché, elle n’est pas en mesure d’être une source de développement, au sens entendu plus haut, ce qui suppose, par delà et avec la création de richesse, sa répartition. Le développement passe alors et encore plus par un État social, c’est-à-dire la production de services pour l’ensemble de la population en matière d’éducation, de santé, de services sociaux, d’infrastructures routières, de ressources énergétiques renouvelables, etc…lequel État bougera dans cette direction pourvu qu’on l’y pousse.
Autrement dit la transition écologique de l’économie va demander beaucoup en termes de détermination politique [1] : des investissements majeurs pour transformer nos infrastructures (passage à la priorité du transport en commun) ; une production énergétique qui passe des énergies fossiles aux énergies renouvelables ; des bâtiments industriels, commerciaux, résidentiels assurant le maximum d’efficacité énergétique, une agriculture écologiquement intensive, etc. Cela ne peut se faire que dans le contexte d’une production globale en expansion et d’une volonté politique qui l’accompagne avec des incitatifs de toute sorte (une écofiscalité par exemple). Le contraire de ce que les tenants de la décroissance avancent.
On le voit et le déduit, il s’agira d’une production globale qualitativement différente de celle d’aujourd’hui qui causera des pertes d’emplois dans certains secteurs (raffineries de pétrole par exemple) mais en créera dans d’autres. Mais dans cette démarche, la démocratie s’imposera, c’est-à-dire le consentement politique à discuter sur le fond avec les principaux concernés et leurs organisations de la transition à faire.
Hier, c’est-à-dire au moment de la révolution industrielle du 19e siècle, la conscience de l’empreinte humaine sur l’écologie de la planète ne se posait pratiquement pas. Les connaissances scientifiques sur cette question ont fait un grand bout de chemin surtout depuis le premier grand document international à ce propos paru en 1972 (Halte à la croissance? Premier rapport du Club du Rome). Désormais, le réchauffement climatique, l’affaiblissement de la biodiversité, la pollution des océans, etc.. sont devenus des caractéristiques majeures de la situation actuelle de la planète. Nous sommes donc contraints de nous interroger sur la production agricole industriellement intensive et donc polluante, sur l’aménagement non durable des forêts et ses effets sur le réchauffement du climat, sur les transports individuels (auto) ou collectifs (autobus, camions, avions) à base d’énergies fossiles (pétrole, gaz), sur la manière de disposer de nos déchets industriels et domestiques, sur la manière de développer une efficacité énergétique des bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels..
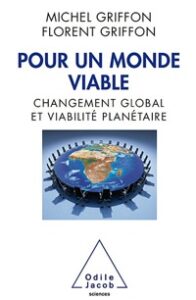 Dans chacun de ces cas, la question première n’est plus : si ce secteur crée de la richesse et de l’emploi, on fonce en investissant, en mobilisant la main-d’œuvre requise etc.. C’est plutôt : est-ce pertinent écologiquement parlant? Et dans chacun des secteurs mentionnés, des nouvelles solutions existent déjà : une agriculture écologiquement intensive, çà existe (Griffon, 2006 et 2011); un aménagement durable des forêts, c’est possible (CQCM, 2001); des transports non polluants aussi (IREC, 2011, projet de monorail); une alimentation des communautés en énergies renouvelables (géothermie, solaire, biomasse, électricité), çà existe; de l’habitat écoénergétique aussi. Les solutions techniques existent, des initiatives de certains groupes et même de certains pays démontrent qu’on peut casser le système de causes provoquant le réchauffement climatique, la crise alimentaire, etc. C’est la volonté politique qui est faible parce qu’elle est constamment miner par des intérêts financiers et les intérêts de grandes multinationales (filière agroalimentaire, filière des énergies fossiles…). À Rio+20, il y aura des grandes organisations qui discuteront avec des chefs d’État à ce sujet et simultanément un Sommet des peuples qui réunira des milliers de participants. Qu’en résultera-t-il? Nous suivrons le dossier!
Dans chacun de ces cas, la question première n’est plus : si ce secteur crée de la richesse et de l’emploi, on fonce en investissant, en mobilisant la main-d’œuvre requise etc.. C’est plutôt : est-ce pertinent écologiquement parlant? Et dans chacun des secteurs mentionnés, des nouvelles solutions existent déjà : une agriculture écologiquement intensive, çà existe (Griffon, 2006 et 2011); un aménagement durable des forêts, c’est possible (CQCM, 2001); des transports non polluants aussi (IREC, 2011, projet de monorail); une alimentation des communautés en énergies renouvelables (géothermie, solaire, biomasse, électricité), çà existe; de l’habitat écoénergétique aussi. Les solutions techniques existent, des initiatives de certains groupes et même de certains pays démontrent qu’on peut casser le système de causes provoquant le réchauffement climatique, la crise alimentaire, etc. C’est la volonté politique qui est faible parce qu’elle est constamment miner par des intérêts financiers et les intérêts de grandes multinationales (filière agroalimentaire, filière des énergies fossiles…). À Rio+20, il y aura des grandes organisations qui discuteront avec des chefs d’État à ce sujet et simultanément un Sommet des peuples qui réunira des milliers de participants. Qu’en résultera-t-il? Nous suivrons le dossier!
Pour en savoir plus
(2011), Vers Rio 2012. La planète sera solidaire ou ne sera plus. Cahier spécial du journal Le Devoir, 15 et 16 octobre. Disponible sur le site du GESQ
(2012), Vers Rio 2012. Économie et environnement. Cahier spécial du journal Le Devoir, 21 et 22 avril. Disponible sur le site du GESQ
Bourque, G. , L.Favreau et E. Molina (2012), Le capitalisme en crise, quelle réponse des coopératives ? dans la revue Vie économique, vol.3, numéro 4, Éditions Vie économique, coopérative de solidarité, Montréal.
CQCM (2011), Biocarburants ou bioénergies ? Vers une solution coopérative, Conseil de la coopératon et de la mutualité du Québec, Lévis.
Favreau, L. et E. Molina (2011), Économie et société, pistes de sortie de crise, PUQ, Sainte-Foy.
Gadrey, J. (2010), Adieu à la croissance. Bien vivre dans un monde solidaire. Éd. Les petits Matins/Alternatives économiques, Paris.
Griffon M. et F.Griffon (2011), Pour un monde viable. Changement global et viabilité planétaire. Éd. Odile Jacob, Paris.
Griffon, M. (2006), Nourrir la planète, Ed. Odile Jacob, Paris
Laplante, R. et alii (2011), L’électrification du transport collectif : un pas vers l’indépendance énergétique du Québec, IREC, Montréal.
Lipietz, A. (2012), Green Deal. La crise du libéral-productivisme et la réponse écologiste, Éd. La Découverte, Paris.
Petrella, R. (2012). Entretien en mai pour le Sommet international des coopératives
[1] Certains parlent de la nécessité politique d’entrer dans une véritable économie de guerre comme ce fut le cas des États-Unis lors de la 2e guerre mondiale. Voir à ce propos l’économiste et sociologue Gilles Bourque avec qui j’ai eu un entretien sur mon carnet
Louis Favreau
Articles de cet auteur
- Solidarité internationale en temps de pandémie : pompiers de service ou architectes du développement ?
- Développement économique local dans les pays du Sud : l’avenir des services énergétiques
- Solidarité internationale et développement des communautés à l’heure de l’urgence climatique
- Agriculture au Québec et dans le monde : la transition sociale-écologique est déjà là !
- Le modèle progressiste à venir sera-t-il social-démocrate ou social-écologique ?


